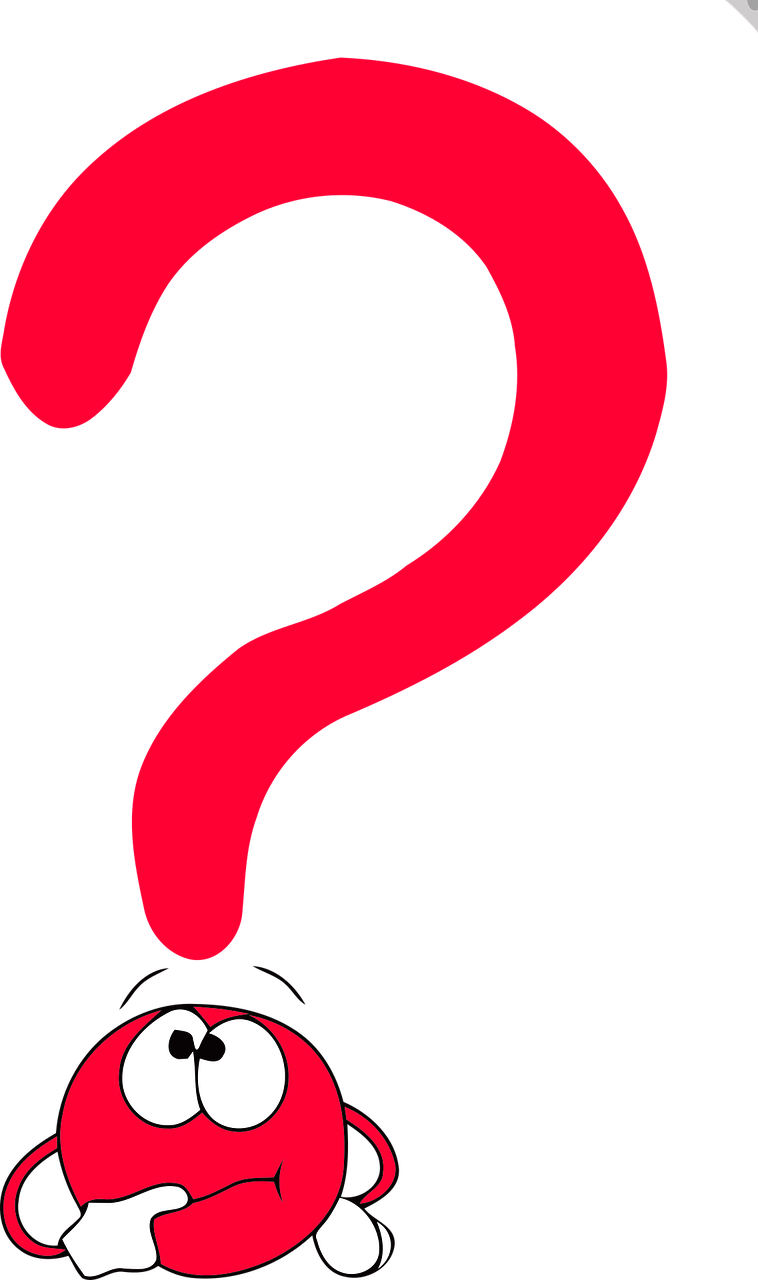Chers amis, Vous vous demandez peut-être comment contribuer à l'amélioration de notre société à la dérive et disons-le carrément, en train de devenir infecte. Eh bien commencez donc par la conversation ! Avez-vous remarqué que, disons huit fois sur dix, quand vous parlez de vous à quelqu'un, même une minute, la réponse qui vous revient est quelque chose comme : « Ah, c’est comme moi, mon chien fait pareil » ou bien : « J'ai un cousin qui… » ou encore « Ma tante ne fait pas de vélo, mais par contre… ». Et là, c'est parti pour cinq longues minutes, ou bien plus si vous ne faites rien. Mais pourquoi ? Eh bien, et pardonnez-moi, chers amis, mais pour une fois je vais utiliser un langage terriblement trivial : parce que votre interlocuteur n'en a strictement rien à foutre de vous et que seule sa petite personne l'intéresse. Eh oui. Or ça, ce n'est pas ce qu’on appelle une conversation, car une conversation implique d' écouter l'autre avant de parler soi-même. Chacun son tour. Essayez et vous verrez que vous aimerez ça, si d'aventure vous faites partie aujourd'hui de ces mécréants de bas étage qui interrompent systématiquement leurs vis-à-vis et ne parlent que d'eux. Réintroduire un peu de civilisation dans la barbarie de notre époque, c’est par exemple apprendre à regarder et écouter l'Autre, plutôt que l'ignorer ou pire encore l'insulter. Mes amis, conversons, parlons-nous vraiment ! A lire absolument : le superbe livre de Pierre Sansot, Le goût de la conversation , Desclée de Brouwer, 2003. Photo : MabelAmber

Jeux Olympiques et Paralympiques Un public français survolté et chauvin Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques "Paris 2024", certains discutaient pour savoir si le comportement du public français relevait du chauvinisme, du patriotisme ou du nationalisme… Quiconque a assisté à ces Jeux -par ailleurs inoubliables- aura constaté à quel point les Français se sont livrés à un véritable délire d'encouragements à leurs représentants. Je suis allé trois jours à Paris pendant les Paralympiques et je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles. Un exemple parmi d'autres, le pongiste Clément Berthier opposé à l'Ukrainien Nikolenko. Le public de la Porte de Versailles ne faisait pas qu'applaudir les points marqués par le Français, il applaudissait aussi les fautes de l'Ukrainien. Et c'est là qu’est le problème (un des problèmes). Aller encourager ses champions inclut-il à la fois le salut de leurs exploits et les erreurs de l'adversaire -parfois il est vrai provoquées par son propre champion, mais pas toujours. On peut aimer le carnaval, se peindre en tricolore -les joues surtout- agiter des milliers de drapeaux mais aussi peut-être aimer un peu le sport… Au fond, pourquoi pas ? Une joie ambigüe Faut-il pour autant montrer autant de Schadenfreude , disent les Allemands (quasi intraduisible en français : mauvaise joie, joie malsaine, ressentie devant le malheur des autres) ? Autant d' excitation exacerbée , personnellement, m'épuise et même m’écoeure. Il faut en plus savoir que ce soutien assourdissant, à la limite de l'obligatoire (bonjour Orwell et son décidément incontournable 1984) n’est ni naturel ni spontané. Non il est littéralement orchestré par des ambianceurs . Tony Estanguet, par ailleurs formidable organisateur de ces Jeux semblait bien se réjouir d'avoir engagé mille (!) de ces ambianceurs sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Avant chaque début de session l'ambianceur de service vient face aux tribunes expliquer au public comment montrer qu'il est là : par le clapping , les hurlements de joie etc. Les Allez les Bleus ! résonnent eux tout naturellement, sans besoin de mode d’emploi. Ils n’en sont pas moins abrutissants. Contre les étrangers ? Certes ceci n'est pas nouveau ; il suffit par exemple de voir l'horrible l'évolution des matchs de Coupe Davis en tennis, avec des joueurs étrangers jetés aux fauves. Mais cette organisation méthodique des soutiens, et donc des émotions, fait peur. Apparemment, dans les évaluations, le patriotisme incarne des valeurs positives : on est patriote parce qu'on aime son pays et qu'on le fait savoir. Mais aimer son pays veut-il dire ne pas aimer les autres ? Nous avons traité dans notre texte précédent des attitudes et des propos résolument partisans et profrançais des commentateurs (journalistes ?) de France Télévisions. Nous ne dirons pas des comportements des commentateurs de la télé et du public français qu'ils n’ont été que patriotes. Ils n'ont pas seulement été pour les Français, ils ont souvent été contre leurs adversaires étrangers. Ceci est resté dans des limites raisonnables mais c'est indéniable. Chauvinisme paraît plus adapté pour caractériser ce parti pris assumé pendant les épreuves, comme lors des fêtes hallucinées au Club France à La Villette, en l'honneur des médaillés français. Le chauvinisme, lui, revêt une connotation négative que n’a pas le patriotisme. Reste le nationalisme . Ce terme peut aussi s'appliquer à ces Jeux Olympiques, quoiqu'en disent certains. Mais le nationalisme est plus large. On y pense davantage pour caractériser une guerre, des positions politiques, que pour du sport. Il n'empêche. Quel "esprit olympique" ? Les Jeux Olympiques 2024 ont bien été -aussi- une fête nationaliste, à l'intérieur d'une immense manifestation -les Jeux Olympiques de l'Antiquité à nos jours- censée représenter une philosophie universaliste et une trêve, une période de paix. Vouloir la défaite de l'autre autant, voire plus, que la victoire des siens n’y correspond pas. Malgré la beauté époustouflante de bien des moments de ces Jeux (cf. notamment la brillantissime cérémonie d'ouverture) il faut ici renvoyer au formidable livre d' Olivier Villepreux « Feu la flamme » (Gallimard, 2008), qui décrit parfaitement la dégénérescence de l'olympisme. Los Angeles réussira-t-il le même miracle que Paris, c'est-à-dire nous faire croire à nouveau à ces moments magiques ? Il faudra déjà voir le comportement des télévisions américaines et du public américain… L'exemple d'Atlanta 1996, avec un traitement quasi unilatéral de NBC en faveur des champions américains, ne nous incite pas à l'optimisme. Un sport où l'on encouragerait ses champions sans délirer et sans se réjouir des fautes de l'adversaire est-il encore possible ? Trouverait-on là tellement de satisfaction en moins que l’actuel festival de chauvinisme ? La question est posée. Photo : Jackmac34

Face à la formidable réussite d'ensemble des Jeux Olympiques (J.O.) et des Jeux Paralympiques de Paris 2024 , peut-on encore seulement émettre quelques critiques ? Faudrait-il adhérer sans réserve aucune à l'enthousiasme général ou bien passer pour un « peine-à-jouir » selon l'expression si élégante et révélatrice d'Anne Hidalgo défendant -à juste titre- "ses" J.O. ? Un superbe bilan Ici il faut distinguer plusieurs choses d'ordres différents qui ont concouru à ce réjouissant succès. -D'abord le magnifique travail collectif des équipes et institutions chargées de l'organisation de ces Jeux. Une affaire de longue haleine étalée sur plusieurs années et orchestrée magistralement par Tony Estanguet . La tâche était colossale, ils ont réussi. Chapeau. Au cœur de cette réussite, l'idée géniale d'intégrer les J.O. dans la ville même. Paris superstar ! Des records en tous genres ont été battus à l'occasion de ces Jeux sans précédent, avec : -des cérémonies, d'ouverture notamment, exceptionnelles et d'une créativité magnifique -la création de lieux de rencontre entre le public et les athlètes, procurant convivialité et splendide ambiance -des forces de sécurité largement à la hauteur, des moyens énormes déployés pour libérer spectateurs et téléspectateurs de la peur des attentats. Celle-ci s'est vite dissoute devant l'ampleur du dispositif mis en place, les consignes de bonne humeur et d'empathie visiblement données aux forces de l'ordre ainsi qu'aux 45.000 volontaires chargés de l'animation et de l'accueil des spectateurs. Ici, le triomphe est total. -l'accent mis sur l'importance de prendre davantage en compte le handicap, avec des Jeux Paralympiques hors du commun et extrêmement inclusifs : de véritables initiation et sensibilisation pour des millions de Français et d’étrangers. Paris et la France -inégalement représentée toutefois- peuvent donc légitimement être fiers de ces Jeux qui feront date. Sans bouder son grand plaisir pourtant, il faut aussi se méfier de ces raz-de-marée populaires emportant tout sur leur passage. Car oui, des critiques il faut en faire et ce d'autant plus que la fête fut grandiose. Ici encore il faut distinguer entre : -le comportement du public français supportant massivement « ses » athlètes -le rôle des médias et en premier lieu de la télévision Les deux, bien sûr, interagissent. Les Français sortaient d'une période d'une extrême morosité et d'une énorme tristesse, notamment politique. Ils avaient envie de « s'éclater » pour penser à autre chose. Ce côté compensatoire a joué un rôle essentiel dans l'excitation, souvent extrême et même « limite » des supporters français. Ensuite, comment peut-on caractériser ce tsunami porté par des gens peinturlurés, agitant frénétiquement des drapeaux tricolores et chantant La Marseillaise à tout bout de champ en soutien aux athlètes de notre pays ? Patriotisme ? Chauvinisme ? Nationalisme ? Nous reviendrons sur ces notions dans un prochain texte. Le travail de France Télévisions Nous n'allons pas ici dresser un tableau complet des J.O. et des Jeux Paralympiques mais nous concentrerons sur la ligne éditoriale de France Télévisions, diffuseur des deux événements. D'abord il faut saluer la performance remarquable des trois chaînes (la 2, la 3, la 5) pour montrer le maximum d’épreuves. Jongler entre de multiples lieux et passer d'un canal à l'autre, en particulier de la deux à la trois et inversement, fut un exercice d'équilibriste brillamment réussi, avec Laurent Luyat, Matthieu Lartot et Cécile Grès comme chefs d'orchestre. J'ai passé beaucoup d’heures à regarder ces Jeux à la télévision et à bien des points de vue les retransmissions ont été un franc succès. Je suis aussi allé trois jours à Paris pendant les Paralympiques pour voir et ressentir, avec mes propres yeux et nerfs, les sites, l’atmosphère, et des compétitions de tennis de table, d’athlétisme, de goalball et de basket-fauteuil. J’ai pu constater l’ambiance festive, la grande qualité des installations, l’accueil chaleureux de volontaires sympas et dansant presque en permanence ! Reste maintenant à examiner la nature, le style et les partis pris de France Télévisions. Face à un objet aussi complexe et « éclaté » en une multitude d’endroits et de sports, quel fil rouge choisir ? « France Télé »n'a fait ni une ni deux : ce serait priorité absolue aux athlètes français et à la comptabilisation, jour après jour, heure après heure, de leurs médailles. Cet accent résolument mis sur les Français a été en outre accentué par de multiples célébrations de médaillé(e)s au Club France à La Villette et par l’émission animée par Léa Salamé et Laurent Luyat ( Quels jeux ! ), mettant en avant à haute dose les participants et médaillés « tricolores ». Il faut également le dire d'emblée : les athlètes étrangers n'ont été ni oubliés ni excessivement critiqués. Dans ce registre, bien pire a été fait par des chaînes étrangères dans le passé (NBC par exemple, sur les Jeux d’Atlanta en 1996). Le parti pris pro français n'en a pas moins écrasé ces J.O. Le critère numéro un d'une diffusion à l'antenne fut ainsi : « Y a-t-il un Français, une Française en compétition ? Et a-t-il (elle) une chance de médaille ? ». Certes, les téléspectateurs français ne brûlaient sans doute pas d'envie de voir un Slovaquie-Albanie de volley-ball assis (match imaginaire…) ! La participation d'un Français a donc été jugée la condition sine qua non pour être diffusé. Un choix compréhensible, mais qui ne saurait dispenser d'un minimum de réflexion critique. Maintenant : comment les rencontres furent-elles commentées ? J'ai déjà eu l'occasion de traiter les commentaires télévisés (du football) dans Le Match de football télévisé (Ed. Apogée, 2007, épuisé) et dans Les Cahiers du journalisme numéro 25, printemps- été 2013 : « Violence sur le terrain en finale de la Coupe du monde de football 2010. Un regard sur les commentaires de TF1 ». Les journalistes de la télévision nationale ont fait défiler devant eux tous les médaillés français, les interrogeant sur leur vécu (toujours la même question : « Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? A quoi avez-vous pensé ? »), en n’oubliant pas le compagnon, la compagne, la mère. Le prénom et la familiarité étaient de mise -à sens unique : « Alors Manon, dites-nous ; bravo Léon ; bonsoir Aurélie ; merci Kylian »… La plupart des champions paralympiques, nous ne les reverrons pas avant quatre ans et d’ailleurs beaucoup d'athlètes olympiques non plus, s'ils concourent dans de « petits sports » -canoë-kayak, taekwondo, voire même escrime, etc. Mais l'idée de la télé était, lors de ces Jeux, de faire de la France une grande famille, unie dans l'amour de ses sportifs, dont beaucoup leur étaient inconnus huit jours plus tôt -et de certains commentateurs aussi ! Le culte des athlètes français, l’obsession des médailles En temps « normal », règne une grande misère télévisuelle pour la plupart des sports. En effet, le foot écrase la concurrence (avec aussi, loin derrière, le rugby, le tennis et le cyclisme). Sur ces J.O., le culte des athlètes français a frisé l'écœurement. Ce culte est-il dans l'ordre des choses, incontournable ? Les Jeux Olympiques sont-ils faits pour que plus de trois semaines durant, tout un peuple célèbre ses propres représentants ? Les athlètes étrangers interviewés ont été une minuscule poignée, à part en athlétisme, où l'anglophone de service Nelson Monfort fut bien utile, comme d'habitude. Mais sinon ? Apparemment, ce qui se passe dans la tête d'un athlète n'est intéressant que s’il est Français. Et puis n’y a-t-il rien d’autre à demander, d’ordre technique ou tactique, d’ordre sportif ? C’est du sport, pas de la psychologie ! Si les J.O. n’étaient pas cette énorme fête patriotique (nationaliste ? chauvine ?) alors que seraient-ils ? Quelle est l'alternative à ce gavage quotidien de candidats aux médailles et aux médaillés de notre pays ? C'est d'ailleurs toujours un peu la même chanson : les J.O. de l’âge de la télévision sont avant tout une multitude de Jeux nationaux au sein de l'olympisme. Est-ce vraiment cela l'esprit des Jeux ? À combien de milliers de kilomètres sommes-nous de la conception antique qui réunissait des athlètes à Olympie ou même de celle du Baron Pierre de Coubertin, qui a fait renaître les J.O. ? La voie choisie par France Télévisions était-elle la seule possible ? Elle a fondé presque exclusivement sa ligne éditoriale sur la « médaillisation » à outrance de l’événement, sur les chances françaises, sur la place de la France dans le tableau des médailles. Et aussi sur les personnalités et émotions des champions français médaillé(e)s. Ceci fait ainsi largement disparaître des écrans les athlètes étrangers, sans les gommer totalement, heureusement. Ce choix fausse notre vision, tout en proposant un travail journalistique terriblement contestable. Nous avons ainsi entendu des journalistes et consultants se réjouir ouvertement d'un geste raté par l'adversaire d’un Bleu... Par exemple, lors d’un match de parabadminton, le 1er septembre, le commentateur : « C’est pas très sport » (de saluer la faute d’un adversaire du joueur français). « Réponse de la commentatrice : « Il ne faut pas se réjouir des fautes du Brésilien, mais un peu quand même… » (sic). Les « Allez les Bleus ! » nous ont assourdis pendant plusieurs semaines, souvent de façon insupportable. Quel abrutissement ! Nous avons même entendu une des journalistes faire entonner La Marseillaise à un petit groupe de gens entourant Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT, visiblement gênée par cette mise à toutes les sauces de notre hymne national. Il n'est déjà pas toujours agréable de voir tout un peuple, bruyamment et inconditionnellement, s'aligner comme un seul homme derrière ses athlètes -qui méritent évidemment d'être soutenus. Mais quand il faut en outre voir les chaînes de la télévision nationale entrer à fond, sans se poser de questions, dans le « patriotisme-chauvinisme-nationalisme », il y a clairement un problème. Un « journaliste » de télévision réduit à sa dimension de supporter -et de vendeur - est-il encore un journaliste ? Il est urgent de s'arrêter et de réfléchir à ce qui se passe là. L’objectivité sacrifiée Un autre trait médiatique a écrasé ces Jeux : l’emphase. Le programme des soirées fut presque systématiquement annoncé comme « somptueux ». Il faut « vendre » à tout prix... Cécile Grès, par ailleurs excellente à bien des points de vue, osa même, un de ces soirs : « Si vous avez prévu quelque chose, annulez tout !! ». Où va-t-on ? Enfin, tout cela fait une grande victime : l’ objectivité . Elle a beau être toujours difficile à obtenir pour un journaliste (et pour nous tous aussi…), elle n’en doit pas moins rester un des phares de la profession. Or il est impossible d’être à la fois chauvin et objectif. Emportée dans le tourbillon des médailles, France Télévisions n’a pas souligné, ou si peu, que la France, 5ème, chez elle et bien que puissamment portée par un immense élan populaire (un avantage massif) n’en a pas moins été devancée aux J.O. par… l’Australie, c’est-à-dire un pays deux fois et demie moins peuplée qu’elle ! Quant aux Jeux paralympiques, c’est pire. 8ème, notre pays a été surclassé par la Grande-Bretagne, et vient derrière les Pays-Bas, l’Italie et… l’Ukraine. Tellement de facteurs entrent ici en ligne de compte et le principe même d’un tableau des médailles (d’or, en réalité) est si discutable qu’il faut néanmoins applaudir la performance d’ensemble de la France. Mais enfin, quid de ces autres pays dont les athlètes ont brillamment concouru ? On aurait aimé (pour le moins…) entendre les Laurent Luyat et Matthieu Lartot analyser ces résultats, expliquer le pourquoi de ces classements. Mais non. Virevoltant dans la fête incessante et dans l’ivresse de médailles pleuvant tous les jours, les journalistes de France Télé n’ont pas analysé grand-chose. Ils ont vibré, comme nous. C’est tout ? Peut-être considèrent-ils qu’ analyser et prendre du recul est le rôle de la presse écrite… Seulement voilà, qui a l’impact le plus fort sur les populations ? Et si un jour, en France, ces procédés n’étaient plus utilisés pour le sport mais pour d’autres causes moins « nobles » ? Journalisme ou propagande , là est la question. Photo : Sammy-Sander

Nous ne devons jamais l'oublier : avec les médias audio et visuels nous sommes confrontés à des dispositifs, des techniques, des styles, des façons de faire qui se trouvent entre notre regard (notre écoute…) et l'événement ou le programme que nous voyons ou entendons se déployer. Cela vaut pour les plateaux de télévision : horrible CNews qui vit du clash permanent et porte à bout de bras les « idées » d'extrême droite, triste BFMTV qui se repaît des annonces de disparition d'enfants et de leurs recherches, ainsi que de crimes divers, presque constamment distillés dans leurs défilants de bas d’écran, qui entretiennent et même attisent la peur sans fournir la moindre solution. Dans son remarquable livre Technopoly , en 1992 (pour la France : éditions L’Echappée, 2019), Neil Postman écrit, dans la lignée de Jacques Ellul : « L’écriture n’est pas une technique neutre, dont l’effet positif ou négatif dépend de l’usage qui en est fait. (…) L’utilisation de n’importe quelle technique est déterminée par sa structure ». C’est un point essentiel, qui va à contre-courant de ce qui est trop souvent affirmé, c’est-à-dire : la technique est neutre, c’est la façon dont on s’en sert qui compte (argument repris, entre mille autres sujets, pour l’arbitrage vidéo au foot). L'impact des technologies sur le foot télévisé Cela vaut aussi donc -et on le sait moins- pour les matchs de foot, par exemple ce que nous voyons en ce moment avec l'Euro. Entre nous et les matchs, il y a en effet les réalisateurs, ceux qui voient pour nous, qui font les choix à notre place, par exemple ce que nous voyons et revoyons ou non au ralenti. Il y a ceux qui choisissent plus ou moins de proximité avec les joueurs, entre les gros plans et les plans larges, ceux qui privilégient la vision individuelle d'une rencontre - plans serrés- et ceux qui préfèrent montrer le jeu collectif et la vision d’ensemble. J'étudie ces questions depuis presque trente ans et ai publié largement (articles, études, livre) sur ce thème. Voici par exemple mes bilans -incluant de nombreuses statistiques- de l’ Euro 2012 et du Mondial 2014. 2 liens " L'Euro 2012 " et " Mondial 2014 ..." Depuis le début des années 2000 environ et jusqu'à présent, les « réals » de foot étaient de trois nationalités seulement : France, Angleterre, Allemagne, comme on peut le constater ici, sur l’Euro 2012 : Lien " Petit guide des réalisateurs " Ceci pouvait surprendre : pourquoi pas d'Italien, d'Espagnol, de Portugais, de Tchèque ? J’ai eu l'occasion d'en parler avec Francis Tellier, patron de HBS (Host Broadcast Service), organisme responsable des retransmissions des Coupes du monde et Euros, jusqu'à ce que FIFA et UEFA en prennent en main eux-mêmes la production. Pour Tellier, ce groupe de réalisateurs de trois nations s'imposait, parce que selon lui ils étaient les meilleurs et aussi parce qu'ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Je l'ai rencontré deux fois, dont une vers 2013 : je lui suggérai alors qu'un réalisateur brésilien s'imposait pour le Mondial 2014 au Brésil. Mais non, le sujet n'avait même pas été abordé : les réals retenus étaient jugés les plus sûrs -avec eux pas de pépins techniques…- ce qui ne les empêchait pas d'avoir des styles différents : priorité au jeu collectif et aux plans larges pour les Anglais et les Allemands, vision plus individuelle et rapprochée des rencontres pour les Français, avec beaucoup de gros plans, beaucoup de joueurs vus seuls balle au pied en action, une diffusion plus hachée, des plans larges bien plus courts… Enfin un Espagnol ! Cet Euro 2024 aura vu une nouveauté : la sélection d'un réalisateur espagnol, Oscar Lago , déjà sollicité pour d'autres compétitions moins importantes de l'UEFA. Le dogme a donc fini par céder et c'est tant mieux. Les options prises par Lago n'ont toutefois rien montré de révolutionnaire, l'Espagnol se fondant sans problème dans la tendance d'ensemble. Nous avons pour cet Euro travaillé sur 19 des 51 matchs et sur une mi-temps chacun. Outre Lago, les cinq autres réalisateurs étaient : François Lanaud (France), Jamie Oakford (Angleterre), Knut Fleischmann (Allemagne), des habitués de longue date de ces grands événements, dont je connais bien le travail. S'y ajoutaient l'Allemand Sebastian Von Freyberg , et Laurent Lachand (France), auteur de la réalisation de la finale du Mondial 2022. Alors que le foot hors stade et hors TV bouge à vitesse grand V -compétitions de e-sport, succès massif des jeux vidéo, futsal…-, les choix opérés par ces réalisateurs n'ont guère évolué toutes ces dernières années. Aucune innovation marquante n'est à signaler cet Euro. La Spidercam (caméra suspendue à un câble, mobile et surplombant le terrain), a confirmé avoir trouvé sa place et son utilité, avec de six à quarante utilisations par match, selon le réalisateur. Toujours « en pointe », L.Lachand n’a cependant pas dépassé les 120 ralentis par rencontre (entre 102 et 116), lui qui, à une époque, en faisait 150 sur Canal ! Les joueurs vus seuls balle au pied et en action sont devenus un critère déterminant pour évaluer le type de réalisation devant lequel on se trouve : ces plans altèrent en effet grandement la vision du jeu collectif (pour quel « plus » réel ?). Lachand, ce réalisateur de l’excès, était à Dortmund autour de 120 par match, avec plus de 200 gros plans sur les visages des joueurs. L’autre français, Lanaud, tint une sorte de voie moyenne : quelque 80 ralentis, 140 gros plans, 90 joueurs vus seuls balle au pied. Allemands et Anglais : vive le jeu collectif ! Les deux Allemands Fleischmann et Von Freyberg, toujours adeptes de la priorité donnée au jeu collectif, étaient autour de quarante joueurs « vus seuls en action », avec un nombre de ralentis raisonnable -quelque 80- et côté gros plans : 90 pour Fleischmann et 170 pour Von Freyberg. Jamie Oakford, lui, autre partisan de la vision du jeu collectif comme impératif, a fait 70-80 ralentis en moyenne, mais surtout il montra beaucoup moins de joueurs vus seuls balle au pied et en action : une vingtaine seulement, ce qui permet aux plans larges de durer et évite au match d’être trop haché. En revanche, il se « rattrape » avec beaucoup de gros plans, insistant ainsi sur l’« intime » et les émotions: environ 130. Rien de bien neuf ni de croustillant sur le plan technique donc cette année et c'est tant mieux. Après certains délires de réalisateurs -notamment les Français, hachant les matchs à qui mieux mieux- tout le monde ou presque semble s'être calmé. Le foot a besoin de raison et de sérénité. C'est du côté du jeu vidéo qu'il faut chercher ce qui bouge et ce qui innove. Lire ainsi cet excellent texte de Cédric Maiore , publié sur ce site : Lien : qui influence qui ?